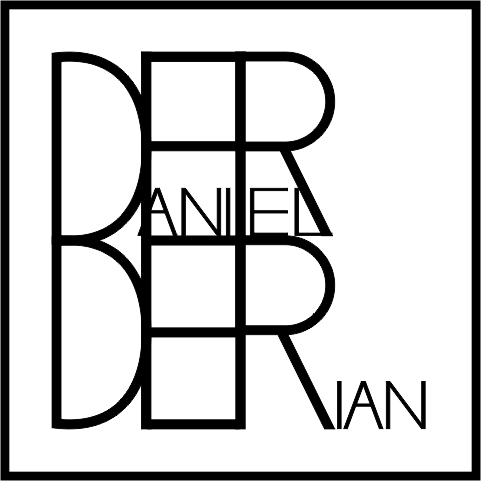Ebloui par le soleil
A peine trois ans, j’adorais me mettre dans la cour. C’était ma première sensation d’escapade. Je fixais le soleil pour après voir des bulles transparentes tomber de ma vue. J’écoutais le mistral. Mes premiers souvenirs d’enfance sont sensoriels et abstraits.
Le soir, du bord de mon landau blanc, ma marraine me chantait une berceuse arménienne ” Khun egir balas” . Ma marraine, mon parrain et leur fils Bernard, les Baghdassarians, vivaient au rez de chaussée. Les Derderian vivaient au premier étage, 1bis, boulevard des Dardanelles, en haut du Vallons des Auffes, le petit port derrière le monument aux Morts sur la Corniche à Marseille, La capitale de la Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Gloire, amour et beauté
La sœur ainée, Betty, étudiait sans arrêt. Elle murmurait ses leçons comme des prières. Toute la famille baissait le ton car ses études étaient sacrées. Elle était le premier enfant de la famille, elle avait endossé la responsabilité de réussir professionnellement et de s’élever du rang social de mes parents. Aujourd’hui elle est une avocate renommée.
Nous avons onze ans de différence et pendant que nos parents partaient travailler, elle était mère et père.
Ma sœur Monique portait toujours du rimmel bleu qui collait. Une horde de garçons l’attendait en vélomoteurs en klaxonnant bruyamment pour l’appeler. Elle disparaissait à l’arrière des scooters. Ses copines étaient blondes et ressemblaient à Sylvie Vartan, mon idole.
Ma mère lui avait interdit de fréquenter une amie dont la maman “recevait”, pendant que Monique et son amie patientaient dans une autre pièce. La maman réapparaissait avec des billets de banque. Un monsieur partait.
A seize ans, elle travaillait comme vendeuse dans un magasin de vêtements de luxe, La Belle Jardinière, rue Saint Ferréol.
Avec elle, mes parents, assez fêtards eux-mêmes, avaient lâché les brides.
Solange, vers quatorze ans, découpait des articles de soins de beauté dans le magazine Mademoiselle. Elle était assez complexée par son nez busqué. Nous la surnommions la sorcière.
A dix-huit ans elle subit sa première intervention chirurgicale. La métamorphose se poursuit jusqu’à ce jour. Elle a toujours été belle.
Plus proche de moi en âge, nous partagions la même chambre. Nous nous tirions par les cheveux jusqu’à ce que le premier lâche un peu. Nous terminions avec quelques restes de cheveux dans les mains. Nous nous disputions l’affection de notre chat, Pompon, en l’attirant vers nous par des petits sons de tendresse. Trop souvent ma sœur gagnait.
La nuit, Pompon sortait dans la rue. Mon père, en slip blanc kangourou, sortait aussi, sifflait, pour que Pompon rentre dormir au bercail.
La prière à table
De grandes fêtes réunissaient oncles, tantes, cousins, et mes grands-parents dans le garage. Les femmes servaient des dolmas, du tchikrima, du baklavas sur une longue table amovible. Les hommes éméchés étaient bruyants et riaient à pleine voix.
Le vin coulait à flot. Après, les hommes se dispersaient dans une des chambres des deux étages pour faire une sieste pendant que les femmes rangeaient, se faisaient des confidences passionnantes sur leurs vies conjugales. Ma mère se plaignait de l’appétit sexuel de mon père et disait se sacrifier.
Mon grand père, du côté de ma mère, au moment de l’exode, avait signé un contrat au gaz de France à l’arrivée même du paquebot dans le grand port de l’Estaque.
Il lisait l’arménien. C’était un signe d’éducation. il était très pieux. La prière arménienne ouvrait chaque repas. Il était ami avec le curé d’une église arménienne. Ce curé passait chaque année chez nous pour bénir et purifier la maison. Il mettait de l’encens dans toutes les pièces. Ma mère ouvrait les armoires pour laisser la fumée pénétrer pour chasser une éventuelle présence maléfique.
Un peu plus tard, il bénira mes chaussons de danse.
Ces grands-parents, les Hovaguimian, vivaient dans le quartier populaire du Cannet, en bordure d’une autoroute. Ils avaient des poules et cultivaient des légumes.
Nous y mangions le dimanche un lapin qu’un oncle avait assommé et dépecé sous mes yeux horrifiés. Néanmoins, cuisiné avec des olives, du vin blanc et de la farine, c’était absolument délicieux. Les repas se terminaient avec une pastèque rafraichie dans un saut plongé dans l’eau du puits.
Mes grands-parents paternels habitaient Saint Antoine, un quartier ou vivaient beaucoup d’Arméniens. Ma grand-mère partait souvent en Amérique pour visiter son frère qui avait choisi ce continent lors de la diaspora pendant le génocide. Un jour, pendant une de ses longues absences, mon grand-père eu une liaison avec la voisine. Ce fut un esclandre à Saint Antoine, la femme et mon grand-père finirent en lambeaux, frappés par la fureur aveugle de ma grand-mère. Elle était très belle, un peu froide. Je préférais ne pas trop rester près d’elle. Je pense qu’elle n’aimait pas trop les enfants. Je grimpait avec ma sœur Solange dans leur jardin sur un figuier et nous nous gavions de figues.
Je garde en mémoire des souvenirs du génocide que ma famille me répétait souvent pour que la génération suivante n’oublie pas. Des viols, des tortures, des enfants massacrés, les turcs qui jouaient à cheval à se lancer la tête démembrée d’un enfant décapité.
Politiques et analyses
Mon père, Jean, était communiste. Pendant la deuxième guerre mondiale, adolescent, il faisait partie de la résistance. Vingt cinq ans après, chaque dimanche, Il allait retrouver au bout de la rue, chez son ami, le docteur Morelli « la cellule Communiste ». Très engagé politiquement, mon père revenait de ces réunions un peu ivre et plein d’idées révolutionnaires qu’il déclamait à haute voix. Parfois il se lâchait lors de fêtes de fin d’année trop arrosées à l’entreprise Merlin Gerin ou il travaillait. Il finissait ivre, debout sur une table.
J’avais un peu honte de mon héros ?
Mon père était un ouvrier engagé pour l’entreprise d’électricité « Merlin Gerin ». Il travaillait dans les soutes des paquebots devant d’énormes panneaux d’électricité, plein de circuits et de numéros qui semblaient très compliqués pour moi.
Je n’ai jamais été très doué ni porté sur les études. J’ai très vite abandonné la compréhension des mathématiques, ça me paraissait une matière sinistre.
Certains dimanches, mon père me trainait d’abord au calvaire, chez le coiffeur. Je détestais ! Je voulais garder ma coupe «Mireille Mathieu».
Après, en compensation, il me menait sur le port de la joliette. Il avait un libre accès. Je grimpais sur ses épaules et nous visitions les paquebots, les soutes, les machineries… Ensuite je lui demandais de me montrer la salle de bal. C’était mon lieu préféré, lieu de rêves.
Le lundi, de retour à l’école, les garçons un peu rustres se moquaient de moi. Ils m’appelaient « Zizou ». Ils me trouvaient efféminé.
Je garde un souvenir mitigé de l’école.
Dehors, j’étais plutôt heureux et insouciant, livré à moi-même.
J’avais un copain, Thierry Lefèvre, il était élevé par sa grand-mère. Nous ramassions des vieux mégots de cigarettes sur le trottoir pour en fumer la fin. Il passait son temps dans la rue jusqu’à très tard dans la soirée. Sa grand-mère partait à sa recherche en chemise de nuit, elle ressemblait à un fantôme.
Ma sœur Solange lisait, un jour, un livre « meurtrière à onze ans, le cas Mary Bell » l’histoire vraie d’une petite psychopathe qui avait étranglé des enfants plus jeunes qu’elle. Moi j’avais douze ans, illumination macabre, ça m’a inspiré à faire au moins des messes noires et des exorcismes.
Ma mère, inquiète, m’a emmené chez un psychiatre, Monsieur Sormani, le mari de sa copine. Ils habitaient rue Paradis, une rue très chic.
Lors de la consultation, il m’a demandé avec un sourire relativisant de tirer ma langue et de dire « ah ».
Il me diagnostiqua un besoin d’activité.
Ma mère confectionnait des robes pour la femme du psychiatre. Elle était Comtesse – La Comtesse D’Arblade de Seilles. Elle aimait se confier abondamment à ma mère. D’en dessous la table, j’écoutais leurs conversations. J’aimais beaucoup Madame Sormani. Elle était très agitée et vivait sa vie comme une fête enfantine. Elle parlait beaucoup de politique, d’histoire de l’art et de sexualité. Elle défendait la libération de la femme et voulait avorter tout le monde. Les robes terminées, ma mère cousait une étiquette «Christian Dior» à l’intérieur. La Comtesse tenait toujours un verre de Whisky avec des glaçons. Avant de partir, ma mère la soutenait pour aller la coucher.
Ma mère était socialiste, mon père était communiste, ma mère était terrorisée. Selon le mari psychiatre, il me fallait une activité. La Comtesse riait.
L’école est finie
Comme activité, j’avais décidé d’essayer la danse. Avec ma sœur Monique nous avons cherché dans le bottin téléphonique l’adresse de l’école de danse la plus proche de mon quartier. « L’Académie de Danse Denise Casanova Cachod ».
Au premier rendez vous, Madame Casanova me demanda d’ouvrir mon blouson pour voir mon torse. Elle dit « très bien » en me donna mes horaires de cours.
Après un cours de danse, j’ai décidé de devenir danseur professionnel.
J’ai affiché dans ma chambre un poster de Jorge Donn et de Susan Farrell. Mon père horrifié a exigé que j’enlève immédiatement «ces conneries». Mes parents me conseillaient de devenir chauffeur de bus. Je fis le chantage de me couper la main et de déposer le morceau de membre sur leur lit.
Après l’épisode de mes messes noires, par prudence, ma mère persuada mon père.
Feu vert pour le lancement de ma carrière de danseur et j’ai pu garder mes deux mains.
J’ai poursuivi mes études jusqu’à la troisième, qui fut assez laborieuse. Installé en fond de classe, j’écoutais fasciné les aventures sexuelles d’une copine dont j’ai oublié le nom et qui couchait avec son oncle.